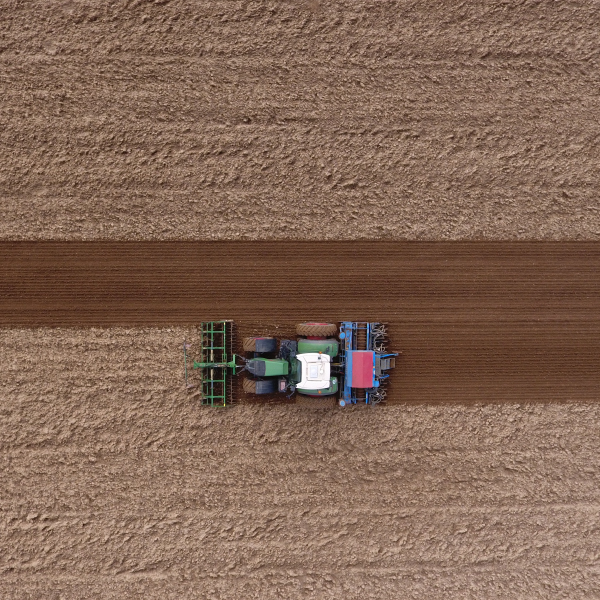La chaire est articulée autour de cinq axes qui offrent chacun un regard complémentaire à la compréhension du fonctionnement interne des nouvelles formes d’entreprises agricoles et de leurs dynamiques. Le premier s’intéresse à l’étude des contours de l’entreprise et aux nouvelles formes de gouvernance, le deuxième à ceux qui dirigent ces entreprises, aux pratiques managériales, à l’organisation du travail et aux usages du numérique. Le troisième axe s’intéresse aux contrats et nouveaux collectifs au service de la création de la valeur et le cinquième à l’insertion des entreprises agricoles dans les filières et les territoires. Enfin, le dernier axe, le sixième, s’intéresse aux indicateurs structurels et comportementaux qui permettent d’identifier, de caractériser et de suivre l’évolution de l’entreprise agricole. Comme nous le préciserons par la suite, cette chaire de recherche aura pour prolongement des actions de formation (initiale et continue) destinées aux cadres ainsi que des actions de valorisation.
Axe 1 : Entreprise et nouvelles formes de gouvernance
L’objectif de ce premier axe est double. Il s’agit, dans une première sous-tâche, de caractériser précisément l’architecture organisationnelle de la grande entreprise de production et la structure de gouvernance associée. Toujours dans le souci de caractérisation des contours de l’entreprise, nous développons dans une seconde sous-tâche une analyse des modèles économiques, qui sont le reflet de la logique de ces formes d’entreprise et de ses stratégies, et qui se traduisent concrètement par la manière dont ces entreprises vont créer de la valeur, la transmettre et la partager entre les différentes parties prenantes de la gouvernance. La seconde sous-tâche est complémentaire avec la première, car les modèles d’entreprise donnent à voir le déploiement stratégique de l’entreprise en termes organisationnel, et permettent d’interroger la capacité des dirigeants à définir des objectifs et à les traduire par une stratégie et un déploiement stratégique adaptés. C’est cette cohérence d’ensemble que nous souhaitons saisir au travers des études de cas réalisées conjointement avec le deuxième axe.

Axe 2 : Entrepreneuriat et nouveaux métiers
Les grandes transformations sociales et économiques de ce début de XXIème siècle parmi lesquelles la globalisation et la financiarisation des activités conduisent à de profondes évolutions des conditions d’emploi et de travail au sein des entreprises. Par ailleurs, comme nous l’avons souligné dans nos travaux antérieurs, les données statistiques relatives au recours à la main d’œuvre dans les exploitations agricoles témoignent de deux mouvements de contractualisation : le premier correspond à un accroissement relatif de la main d’œuvre salariée permanente et saisonnière venant compenser en partie la forte diminution des actifs familiaux au moment même où la taille des exploitations s'accroît ; et le deuxième tient à un recours plus fréquent à une main d’œuvre fournie par des prestataires (entreprises de sous-traitance, agences d’intérim, etc.).
Notre chaire et plus particulièrement ce deuxième axe entend tout à la fois identifier et caractériser les nouveaux métiers de la main d’œuvre mobilisée par les firmes de production agricole, les nouvelles fonctions d’encadrement mais plus largement d’étudier les processus sociaux qui sous-tendent l’évolution des formes d’organisation sociale du travail agricole.

Axe 3 : Contrats et nouveaux outils au service de la valeur
Les filières agricoles sont incontestablement de plus en plus régulées par des politiques publiques de plus en plus contraignantes, et parmi elles, en particulier les normes de qualité des produits et les normes environnementales. L’adaptation, et par delà, l’anticipation des politiques publiques et des normes constitue aujourd’hui un élément majeur du modèle économique des entreprises agricoles. Dans cet axe, il est alors question de nous interroger sur la manière dont certaines entreprises agricoles, notamment de grande taille, articulent différentes catégories de politiques et de normes, et en particulier les normes environnementales avec les règles de fonctionnement et les normes sociales au sein de l’entreprise. Pour les sociologues du travail et les économistes qui ont travaillé sur le lien entre écologisation des pratiques agricoles et travail, dont les outils d’analyse seront repris ici, cela revient à s’interroger sur la manière dont les dirigeants et managers de ces firmes arrivent à « donner sens » à ces normes pour construire de nouvelles légitimités et modalités d’action (déconstruction et construction de nouvelles normes collectives).
Le droit est ici mobilisé pour comprendre la capacité des entreprises à remodeler les normes des filières auxquelles elles participent. Cette approche a pour objet de déterminer la nature (originale ou non ?) des contrats conclus par les firmes avec leurs partenaires de l’aval, ainsi que le contenu des clauses définissant l’équilibre juridique et économique de la relation. Il est également question d’analyser les instruments par lesquels les firmes ajoutent et captent de la valeur par rapport aux chaînes classiques de relations commerciales : quelle place tiennent, en l’occurrence, les normes privées (marques, cahiers des charges) par rapport aux normes publiques d’identification de la qualité ? Au plan méthodologique, l’analyse porte autant sur le cadre juridique général entourant la construction de ces accords que sur leur contenu matériel.

Axe 4 : Nouvelles entreprises, filières et territoires
En France, les organisations professionnelles agricoles ont été pensées le plus souvent pour accompagner et porter un modèle d’entreprise agricole : celui de l’exploitation familiale de taille moyenne. Ainsi, ces OPA ont su déployer leurs actions dans de multiples directions et se décliner à différentes échelles territoriales et par filière. Politique, social, financier, technique, économique… national, régional, départemental et cantonal…, chaque pan de la vie des agriculteurs et chaque échelon administratif est couvert par une OPA. Les syndicats, les instituts techniques, les chambres d’agriculture, les coopératives et mutuelles agricoles comptent parmi les exemples les plus connus. Ces organisations proposent un large panel de dispositifs et de services structurant l’action collective, qu’ils portent sur le partage de ressources humaines et l’entraide, la diffusion de références technico-économique, l’approvisionnement et mutualisation de moyens de production, la commercialisation des produits, la structure même des exploitations ou encore leur financement.
Il s’agit donc dans cet axe d’étudier plus précisément les relations de coopération et de concurrence entre les nouvelles formes d’organisations de la production agricole et les OPA (dont les coopératives) ; les oppositions mais aussi les alliances entre ces entreprises et les OPA ; les relations et tensions entre OPA, qui loin de constituer un ensemble homogène, sont aussi traversées par des oppositions quant à la stratégie à adopter face au développement de ces grandes entreprises agricoles. Nous cherchons, à travers ce quatrième axe, à mieux comprendre comment ces nouvelles formes d’organisations de la production tentent de s’émanciper des organisations professionnelles traditionnelles en proposant une offre de services proches voire identiques ou en créant de nouveaux collectifs de producteurs.
Il s’agira également de comprendre et d’analyser la coexistence parfois complexe entre les nouvelles formes d’organisation de la production agricole et des exploitations familiales traditionnelles. Loin de correspondre à un continuum correspondant à différents niveaux de développement, ces différents modes d’organisation de la production se renforcent souvent dans leurs écarts et différences. L’originalité de notre projet est d’envisager la coexistence au travers des conflits pour offrir un regard complémentaire à la manière dont les études récentes appréhendent la coexistence des modèles d’agricultures familiales et autres.

Axe 5 : Modélisations et construction d’indicateurs
Traditionnellement, la performance globale de l’entreprise est centrée sur l’efficience et l’efficacité économique. L’acception contemporaine de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) permet de prendre en considération aussi les impacts sociaux et environnementaux des décisions managériales d’entreprises d’une certaine taille. Avec le changement de paradigme en agriculture, la notion de RSE gagne aujourd’hui le monde des entreprises agricoles. C’est en particulier le cas des coopératives agricoles qui cherchent aujourd’hui à développer une démarche RSE pour tout à la fois accroître leur valeur ajoutée, fidéliser leurs adhérents et asseoir leur légitimité au sein du territoire. En nous inspirant de la lecture à la fois analytique et critique de la RSE, nous cherchons à développer dans ce dernier axe une analyse de la relation récursive entre performances et pratiques de management de l’entreprise agricole.
Nous nous fixons ainsi deux objectifs : (1) mesurer les différentes dimensions de la performance globale de l’entreprise ; (2) analyser à la fois les déterminants externes de la performance et la manière dont les parties-prenantes se fixent des objectifs de performance et déploient des stratégies (techniques, organisationnelles, spatiales, politiques…) pour les atteindre. Cet axe est alors organisé autour de 3 sous-tâches : l’évaluation des performances économiques et financières ; l’évaluation des performances environnementales ; et l’évaluation des performances sociales avec une entrée privilégiée par les conditions de travail.